Étiquettes
-300x460.jpg)
Quatrième de couverture :
Comme beaucoup de jeunes Péruviens, Alberto Coiro est venu chercher du travail à Santiago du Chili, et lorsqu’il disparaît brutalement Heredia, le détective privé mélancolique et désabusé, se laisse persuader de partir à sa recherche. Il explore, sous la conduite d’un vieil homme, l’univers des vagabonds et des chiffonniers qui, la nuit, envahissent la ville. Il découvre les réseaux de jeux clandestins, les salles de billard, le trafic de cocaïne et tout un monde de personnages glauques. Mais il croise aussi le sourire de la jolie Violeta et se laisse émouvoir.
Dans son enquête il est aidé par les conseils philosophiques de Simenon, son chat. Flanqué de ses complices habituels, Serón le flic à la retraite, Anselmo le kiosquier turfiste et le journaliste Campbell, il nous montre le Santiago de l’émigration et du racisme.
Quel plaisir de retrouver le détective privé Heredia que j’avais découvert en 2014 dans Les sept fils de Simenon. Depuis j’ai pu trouver deux autres de ses enquêtes ou aventures en librairie, tout n’est plus disponible malheureusement (et je refuse de commander chez le gros truc en jaune qui est tout sauf un libraire).
Comme dans le premier roman lu, l’enquête en elle-même n’est pas l’intérêt principal du livre, quoique les recherches d’Heredia touchent toujours à un problème politique ou social du Chili de l’après Pinochet. Ici il s’agit de l’immigration péruvienne, des centaines de travailleurs pauvres qui s’exilent au Chili, sans papiers la plupart du temps et qui trouvent notamment des emplois dans les bars, les restaurants de Santiago. La nuit ils s’entassent dans des « boîtes à sommeil » et rêvent de rentrer chez eux un peu plus riches qu’avant. Heredia doit donc enquêter sur la disparition de l’un d’entre eux, Alberto Coiro. Son enquête, qui va longtemps errer sans piste véritable, finira par mettre au jour des trafics bien sombres ourdis autour d’une salle de billard.
L’intérêt de ces romans noirs, c’est de rouler ou de marcher dans Santiago du Chili avec Heredia, de suivre cet homme nostalgique et désabusé dans les bars, les restaurants, les rues de la ville tentaculaire et de fréquenter une faune hétéroclite et plus ou moins honnête qui ne parviendra jamais à faire renoncer Heredia à trouver le ou les coupables et à faire justice (dans la mesure du possible). Quand il rentre à la maison, il retrouve son chat blanc Simenon et ils se parlent ; Simenon porte ce nom car, quand il est entré par hasard chez Heredia, tout maigre, affamé, perdu, il s’est couché sur quatre romans de Simenon. Car oui, autre plaisir de cette série, c’est que le privé est cultivé, il aime lire, les citations des grands auteurs lui coulent aisément des lèvres. Et bien sûr, pas de roman noir sans personnage féminin, ici la belle et intelligente Violeta qui offrira quelques moments de douceur et de douleur mêlées à notre détective.
Hasta luego, Heredia, je serai heureuse de te retrouver dans d’autres investigations.
« En revenant vers mon bureau je me suis arrêté devant un mur sur lequel quelqu’un avait écrit : “Dehors, les Péruviens.”
J’avais déjà lu ce genre de graffiti, ils accusaient les Péruviens de faire entrer la tuberculose au Chili, d’augmenter la délinquance ou de priver les Chiliens de leur travail.
Certains étaient anonymes, d’autres signés par des groupes néonazis qui exprimaient tous les jours leur nationalisme odieux sur les murs du quartier dans l’indifférence générale.
Rien de nouveau sinon la stupidité vieille comme le monde de croire qu’un nom, la grosseur d’un porte feuille ou la race fait de vous un être supérieur. »
« Le chat attendait que mon corps fatigué par une nuit blanche revienne à la vie par ses propres moyens. Il a gentiment passé sa patte sur mes cheveux. Le soleil maussade de l’après-midi entrait par la fenêtre et j’ai senti dans mon estomac un furieux besoin de café et de tartines.
– Tu as vu l’heure ? La Péruvienne t’a ramolli le cerveau. Qu’est-ce que tu espères ?
– Rien. Je n’espère rien. J’étais seul et elle est arrivée en rêvant d’être ailleurs. C’était juste un petit moment de tendresse, une autre manière de passer le cap de la nuit.
– Ta naïveté est touchante. Hier, deux hommes sont venus pendant ton absence, je les ai entendus marmonner devant l’entrée. Ils ont glissé des lettres sous la porte. Tu as dû perdre deux clients.
– Les notes que j’ai trouvées ce matin le confirment. Il y avait aussi quelques grossièretés mais je ne les répèterai pas pour ne pas blesser tes oreilles, fouille merde de chat.
– Que penses-tu faire ?
– J’ai gagné assez d’argent aux courses pour payer mes vices et les tiens.
– Je faisais allusion au Péruvien et non pas à tes maigres revenus. »
Ramon DIAZ-ETEROVIC, La couleur de la peau, traduit de l’espagnol (Chili) par Bertille Hausberg, Métailié, collection Suites, 2013 (Métailié, 2008)
Le Mois latino-américain chez Ingamnic – Chili
Petit Bac 2021 – Couleur 2

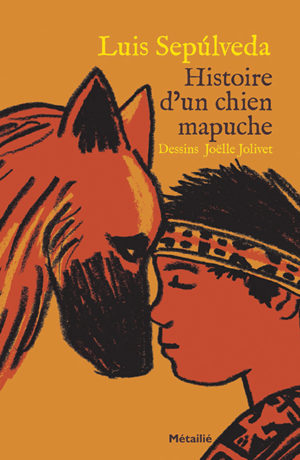

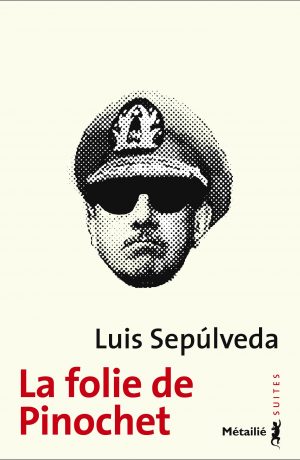
-300x460.jpg)









