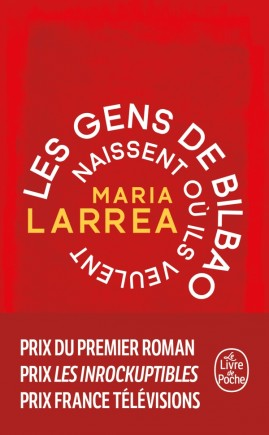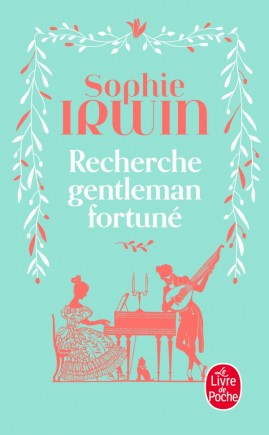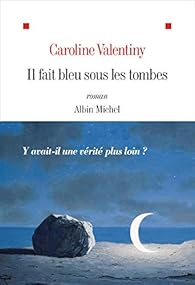Étiquettes

Quatrième de couverture :
Au début des années 1970, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c’est un homme taiseux, secret sur son passé. À la fin de sa vie, Rami est atteint d’amnésie. Ses souvenirs semblent s’être arrêtés quelque part entre l’Irak et la France : il a oublié l’exil. Son fils, Euphrate, lui raconte alors ce qu’il en sait, avec l’espoir de percer enfin les secrets de l’histoire de son père. Cette quête le plongera dans le tumulte de sa propre odyssée familiale, de Paris à Falloujah. Un premier roman chavirant de la mémoire retrouvée, un livre inoubliable sur l’identité et la transmission dans lequel père et fils renouent le fil rompu d’un dialogue aussi bouleversant que nécessaire.
La construction de ce roman lui donne tout son intérêt. Un fils confronté à la double maladie de son père en fin de vie se souvient de son enfance et de sa jeunesse marquées par les silences de ce père originaire d’Irak. Il a toujours cherché à connaître l’histoire de ce père qui a fui son pays et s’est enfermé dans un mutisme obstiné. Euphrate, le fils (Euphrate – Feurat, tiens tiens), « profite » de l’amnésie de son père pour tenter de reconstituer les souvenirs. On voyage donc entre France et Irak, entre l’enfance de Rami, né en 1944 à Falloujah, celle de son fils narrateur, aux derniers jours de Rami en passant par l’histoire irakienne depuis 1958, lors de la révolution qui a renversé la monarchie au profit du général Qassem qui sera lui-même renversé par un certain Saddam Hussein, jusqu’à 2003, chute du dictateur. Rami, le père du narrateur, a fui son pays en 1972 et n’a jamais raconté la douceur perdue de son enfance ni sa jeunesse engagée. Il n’a jamais voulu retourner là- bas, où son fils a cherché des réponses et a vu l’évolution désastreuse de l’Irak avec l’occupation américaine.
C’est un roman à la fois émouvant et glaçant, avec une nostalgie inguérissable, un roman sur la mémoire, la filiation, la paternité, la dictature, l’exil. C’est le premier roman de Feurat Alani mais il connaît très bien son sujet puisqu’il est journaliste et grand reporter d’origine irakienne. Il a notamment tourné un documentaire sur l’usage des bombes à uranium appauvri à Falloujah.
« Falloujah était une ville de l’entre-deux, une jolie petite bourgade pleine de contradictions et de paradoxes. Située dans une vallée fertile, bordée par l’Euphrate, elle était aussi entourée de sable pourpre, l’été. Une cité tantôt paisible, tantôt bruyante, ni trop près ni trop loin des trépidations de Bagdad, où flottait un parfum floral qui laissait souvent place aux effluves de crottin de mulet au détour d’une rue. »
(p. 59)
« – L’Irak que tu vas voir est une dictature.
– C’est quoi une dictature ?
– C’est un pays où tout le monde murmure. Toi et ta sœur, évitez de parler trop fort, on ne doit pas parler à voix haute, sauf si ce n’est pas important. Tu comprends ? »
« Aujourd’hui, je le sais. La mémoire est un art choisi, un canevas blanc sur lequel on fait courir des pinceaux de couleurs, pour un résultat bien loin de la représentation exacte de la réalité, mais proche d’une vérité subjective, celle qui nous habite à l’instant où nous la vivons. La mémoire n’est pas forcément une reproduction fidèle de ce qui s’est réellement passé. Elle retient aussi bien ce qu’elle désire que ce qu’elle abhorre. » (p. 282)
Feurat ALANI, Je me souviens de Falloujah, Le Livre de poche, 2024 (Editions Jean-Claude Lattès, 2023)
Prix des lecteurs du Livre de poche – sélection Avril 2024 (je vote pour ce livre)
Après ce billet, je me mets en pause, le temps des vacances scolaires. J’ai programmé deux billets musicaux et un peu de poésie. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d’en avoir et bon début de mai à tous.