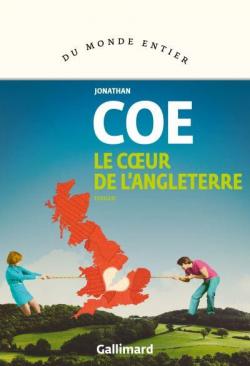Étiquettes

Quatrième de couverture :
« Il n’y a que des mots d’amour, les autres n’existent pas. Je vais chercher, au fond de moi, toutes les routes que j’ai parcourues, celles qui m’attendent. Les visages que j’ai aimés, les autres ont disparu dans la brume de la mémoire. Oublierai-je le visage de cet homme que je n’ai jamais vu ? »
Écrivain en mal d’inspiration, le narrateur se rend dans un village de Provence où un riche propriétaire lui a confié la garde d’un monastère inhabité, niché dans les collines. Il s’y installe avec pour seule compagnie un petit chet at nommé Solex. Un soir, en débroussaillant l’ancien cimetière des moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Mais quand il revient avec les gendarmes, la jambe a disparu… Qui a été tué ? Et par qui ?
Ca y est, j’ai enfin découvert la plume de René Frégni et je suis conquise !
Dans ce roman assez court, on est dans la contemplation, l’amitié, la tendresse et le coeur palpite un peu avec cette histoire de jambe déterrée. A la fin, on est aussi dans la transgression mais j’ai cru comprendre que la vie de l’auteur lui-même n’est pas dans le respect absolu des règles. Il y a sans doute un peu de lui dans le personnage principal, cet écrivain en mal d’inspiration engagé par un employeur mystérieux comme gardien d’un monastère vide, perdu au fin fond de la Haute-Provence. Il va passer le printemps et l’été à tailler, débroussailler les abords du monastère, à se remémorer son enfance à Marseille, l’amour des livres transmis par sa mère. L’amitié lumineuse du couple de libraires qui lui a trouvé cet emploi, la joyeuse liberté d’un ouvrier couvreur traversent la solitude qu’il a librement choisie, comme Benoît de Nursie et Bernard de Clairvaux dont les statues se dressent à l’entrée de l’abbaye. Et puis il y a la tendresse d’une petite boule de poils blancs qu’il a trouvée et apprivoisée dans les jardins, une petite boule ronronnante qu’il surnommera Solex. Jusqu’au jour où une jambe humaine sort de terre dans le cimetière des moines…
L’écriture de René Frégni est magnifique, emplie du soleil de l’été et des brumes automnales, de parfums et d’odeurs, d’arbres et de champignons, de pages blanches et de flammes bondissantes. Si notre auteur gardien jardinier nous fait voir et admirer une nature sublime, tout n’est pas idyllique dans ce paysage : il y a de la sauvagerie dans ces forêts, la neige peut vous couper du monde en une nuit, mais on peut toujours se relier à la terre, à soi et aux autres grâce au travail dans cette nature et… aux livres. J’aurais voulu noter des phrases et des phrases tant c’était beau.
« Solex saute sur mon ventre et pendant des heures nous regardons danser les flammes orange et bleues. Comme chez tous les chatons et les bébés, sa tête est plus développée que son corps ; machinalement je la caresse en regardant les bûches s’effondrer dans la braise. C’est un plaisir dont on ne se lasse pas et qui dure depuis que le premier chat a rencontré le premier homme. Un bon feu, cette petite fourrure duveteuse qui vibre sur mon ventre, des murs d’un mètre d’épaisseur autour de nous, la nuit qui vient. Que demander de plus à l’automne ? » (p. 34)
« J’ai passé ma vie à chercher des vallons perdus, semblables à celui-ci, des cabanons écartés pour lire des journées entières dans un silence de feuilles. Je lis quelques pages, je lève les yeux, un nuage glisse dans la lumière… J’écoute cette forêt tout autour, elle respire, palpite, frémit, s’égoutte des pluies de la nuit. Mon pas craque, quelque chose détale, s’envole, une branche délestée fouette le feuillage. Je n’ai jamais été entouré d’une telle quantité de silence. »
« J’écris le mot tilleul et je suis tout de suite sous un tilleul, le mot lessive et je revois ma mère étendre des draps dans la lumière du jardin et la joie de sa jeunesse. Rien n’est plus magique que l’écriture, elle va chercher des débris de vie dans des replis secrets de nous-mêmes qui n’existaient pas cinq minutes plus tôt. On croit avoir tout oublié, on allume une lampe, lampe, on se penche sur un cahier et la vie entière traverse votre ventre, coule de votre bras, de votre poignet dans ce petit rond de lumière, un soir d’automne, dans n’importe quel coin perdu de l’univers. » (p. 36-37)
« J’avais grimpé au cœur d’un arbre et je regardais, ébloui, la féerie du monde. Qui aurait pu se douter, face à tant de beauté, à l’intelligence si parfaite de toutes ces couleurs, à cette explosion de vie, que nous avions rendu en quelques années cette planète malade ? Il y a cent mille ans, des hommes avaient regardé comme moi, peut-être perchés dans des arbres, ce spectacle grandiose. Étions-nous trop prétentieux, trop bêtes, pour dédaigner ainsi cette beauté , pour la saccager ? » (p. 88)
« Depuis quelques jours, l’ombre est plus fraîche sous les arbres. Avec les pluies d’octobre qui ont dû être très fortes dans les montagnes, j’entends rouler le Colostre plus bas, sous les peupliers, et la brume est plus bleue le soir. Les prés sont redevenus gras en trois nuits. Quelques flammes sont apparues sur les coteaux, les érables d’abord puis les plus hauts rameaux des pistachiers térébinthes. Maintenant, c’est toute la forêt qui s’embrase et les petits vergers que j’aperçois au loin quand je monte sur la colline derrière la chapelle. Les abricotiers s’entourent de cercles d’or et les cerisiers filent en longues allées pourpres. »
« -Je vais faire du bois et me chauffer les fesses. Je vais passer l’hiver devant de belles flambées. Je commence à avoir très envie de mon cahier. Tu l’ouvres le matin, tu écris un mot, n’importe lequel, et tu pars en voyage. Pas la peine de faire des queues pour trouver un billet, un hôtel, un taxi… Tout est dans les cahiers ! L’odeur des ports, le vacarme des villes, la couleur des forêts, le regard des femmes…Tu vois, si j’avais tué ce type et qu’on m’enferme pendant quinze ans dans une cellule, je demanderais juste un stylo, un cahier, et personne ne saurait où je passe mes journées. Je serais partout sauf dans ma cellule. » (p. 108)
René FREGNI, Dernier arrêt avant l’automne, Folio, 2021 (Gallimard, 2019)