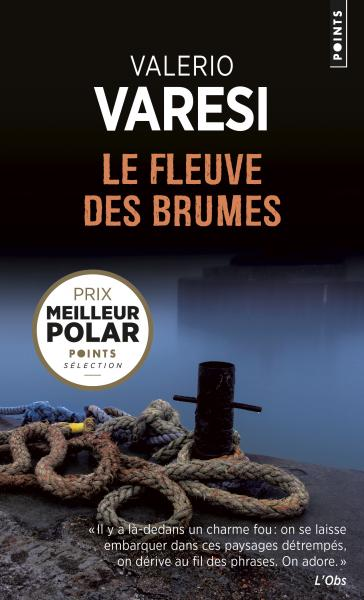Quatrième de couverture :
Dans trois boîtes au grenier se trouve leur correspondance amoureuse. Oserons-nous la lire maintenant qu’ils sont disparus ? Entrer dans la chambre des parents, c’est chercher à comprendre ce qui s’est passé avant notre naissance. Roman des origines que chacune et chacun rêve de découvrir. Au fil de leurs lettres s’écrit aussi notre histoire : sommes-nous nés de l’amour ?
Après Comment j’ai vidé la maison de mes parents, lu en 2015 (déjà !?), voici le deuxième volet de la trilogie autobiographique de Lydia Flem. Dans le premier, elle racontait le deuil, le difficile travail de vider la maison (garder, offrir, vendre ou jeter) et elle comprenait que tout ce que ses parents avaient entassé sans jamais rien jeter leur servait sans doute de rempart contre le vide de leurs débuts, marqués par la Shoah.
Après tout ce travail de tri, il reste trois boîtes remplies de lettres soigneusement numérotées. Des lettres écrites surtout entre 1946 et 1949, depuis le moment où Boris Flem rencontre par hasard Jacqueline Esser à Leysin, dans le sanatorium où elle se fait soigner de la tuberculose sévère contractée dans les camps : résistante, elle a été déportée à Auschwitz et a subi les marches de la mort jusqu’à Ravensbrück. Lui n’a plus de famille ou si peu, on ne s’est d’ailleurs jamais bien occupé de lui, il a lui aussi été déporté dans un camp de travail. Une amitié naît, qui se nourrira de longues lettres et qui se transformera en un amour plus fort que la solitude, plus fort que la maladie et la mort.
Cet amour restera fort toute leur vie. Il pèsera lourd aussi sur leur fille unique : Boris et Jacky étaient tout l’un pour l’autre, ils comblaient l’un pour l’autre toutes les pertes que la guerre leur avait fait subir, la fragilité physique de Jacky lui interdisait toute grossesse et pourtant Lydia est née, heureusement bien désirée, pas le fruit du hasard ou de l’oubli.
« Le traumatisme en héritage : l’agressivité inhibée, impossible de faire du mal, mes deux parents étaient trop fragiles. Seulement être sage et obéissante. Ne rien déranger. Rester immobile. Silencieuse, ramassée sur soi comme quelqu’un qui se cache, qui cherche à demeurer dissimulé. Faire le mort pour sauver sa peau. Ma mère disait qu’au camp elle s’était faite toute petite, invisible, pour se protéger, pour échapper au travail d’esclave, pour ne pas mourir. Tenir des heures dans le froid, à l’appel, au petit matin glacial de haute Silésie. Se cacher dans les latrines. Elle avait 23 ans. Comment vivre lorsqu’on est un enfant de survivants ? Comment oser vivre, rire, bouger, chanter, être heureuse ? Pourtant, ils voulaient que la vie l’emporte sur l’anéantissement. Ma naissance était un miracle à leurs yeux. La vie plus fort que toutes les morts. » (p. 78-79)
La maladie a toujours fait partie de la vie de la famille : régulièrement, Jacqueline retournait en Suisse pour des cures ; plus tard, elle gardera de lourdes séquelles d’un accident de voiture. Cela lui a à la fois forgé un moral de battante mais aussi fait surprotéger sa fille.
« Survivre éveillait un sentiment de culpabilité – culpabilité du survivant, disait-on, – un sentiment de victoire aussi, sur les nazis. Mes parents n’avaient pas partagé le sort des victimes, ils avaient échappé au génocide. Ils étaient meurtris mais vivants. Deux orphelins, deux survivants, s’épaulant mutuellement pour tracer un chemin de vie, c’est ainsi que se noua leur couple. Un couple fondé sur l’interdépendance, le rêve tout-puissant de vaincre la maladie et la mort. Ils s’arc-boutaient contre le monde. Ils voulaient me préserver. Le monde recelait trop de danger. Ils voulaient me les épargner. Ils n’avaient pas confiance dans les forces que l’on peut développer en soi. Leurs expériences leur avaient prouvé que Thanatos l’emporterait toujours sur Eros. « (p. 81-82)
En lisant et en classant ces lettres, Lydia Flem comprend mieux pourquoi elle a toujours senti qu’elle ne pourrait jamais satisfaire sa mère, si avide d’attention et d’amour. Elle a bien sûr réussi à se construire, elle raconte comment l’imagination et la lecture l’ont aidée.
« Je commençai à lire cet été-là et ne m’arrêtai plus jamais. Je me jetais sur mon lit avec volupté, je lisais toute la journée, même tard le soir, sous mes couvertures, à la lumière d’une lampe de poche. L’été de mes 9 ans, je préférai lire au lit, un matin, plutôt que d’accompagner ma mère en ville, pour acheter un cache-pot. C’est ce jour d’août qu’elle eut son grave accident de voiture. Je me suis toujours demandé ce qui serait arrivé si j’avais été présente. Serais je morte ? Ma mère aurait-elle été moins blessée ? Je me sentis longtemps coupable de l’avoir laissée seule, comme si j’avais pu lui éviter son accident. L’idée ensuite me poursuivit que je pourrais, au même âge qu’elle, avoir, à mon tour, un accident grave. Je mis beaucoup de temps à me décider à conduire, mon père m’en dissuada autant qu’il put, arguant absurdement que c’était difficile de trouver une place de parking. Heureusement, lorsque j’eus vingt ans, un ami, à qui j’avais raconté cette histoire, m’offrit symboliquement un porte-clés. Il me le tendit en déclarant que l’on trouve toujours une place pour se garer puisqu’il y a pour chacun une place dans ce monde. » (p. 182-183)
Au final, ce travail sur les lettres, commencé dans le doute, la crainte de la curiosité malsaine a permis à Lydia Flem de faire son deuil, de mieux comprendre ses parents et de se comprendre elle-même.
« Ma lecture m’a permis de passer du temps en leur compagnie. Ce fut un long voyage au pays de l’enfance et de ce qui l’a précédée, tout à la fois éprouvant et émerveillé. Je vis comme une grande chance d’avoir pu recueillir ces love letters que chacun s’attend peut-être à trouver en vidant la maison de ses parents. Par l’imagination, grâce à cette littérature « de grenier », j’ai pu assister à ce qui est arrivé avant ma naissance et l’a préparée. Une expérience unique, modeste et précieuse. » (p. 232-233)
Comme pour le premier tome, cette lecture a été très prenante. L’histoire d’amour des parents de Lydia Flem est touchante et l’expérience intime, personnelle de la fille prend des dimensions universelles par la clarté de son regard de psychanalyste, par la bienveillance qui se dégage de l’ensemble du livre. Je termine avec un passage qui m’a particulièrement parlé.
« Souvent j’ai regretté les frères et soeurs qui ne sont pas nés après moi, mais j’étais fière de savoir que j’avais été désirée. L’amour qu’on a reçu dans sa petite enfance ne disparaît pas, il nous donne une force au fond de soi qui ne peut jamais être vaincue. Malgré tous les reproches que je pouvais et pourrais encore faire à mes parents, je leur dois, à tous les deux, d’avoir été aimée. Même fort, même mal, mais aimée. Sur la partition de notre histoire ne s’effacent pas les étranges détours de l’inconscient de nos parents. Nous avons été modelés autant par ce qu’ils ont voulu nous transmettre que par ce qu’ils nous ont transmis à leur insu. Une généalogie inconsciente, sur plusieurs générations, nous traverse. Nous portons, souvent sans nous en douter, des blessures venues de nos ascendants, d’anciennes missions, de lourds secrets. Il ne nous est pas toujours donné d’en d’éclaircir les ombres, d’en dénouer les liens. Nous faisons notre vie cahin-caha, et à réfléchir à l’histoire de nos parents, de nos ancêtres, nous parvenons parfois à ne pas répéter leurs destins, mais à nous en échapper en partie. À faire un pas de côté. » (p. 178-179)
Il me reste à lire le troisième livre de cette autobiographie, j’espère que je ne mettrai pas autant de temps qu’entre le premier et le deuxième.
Lydia FLEM, Lettres d’amour en héritage, Points, 2013 (Seuil, 2006)
Le Mois belge 2021 – catégorie Esperluète (histoire de famille et d’amour)
Petit Bac 2021 – Objet