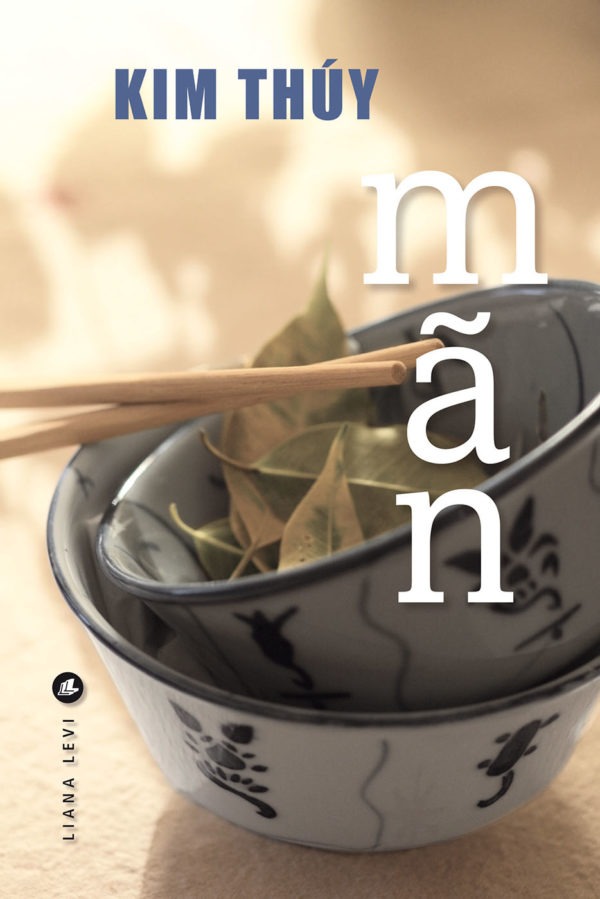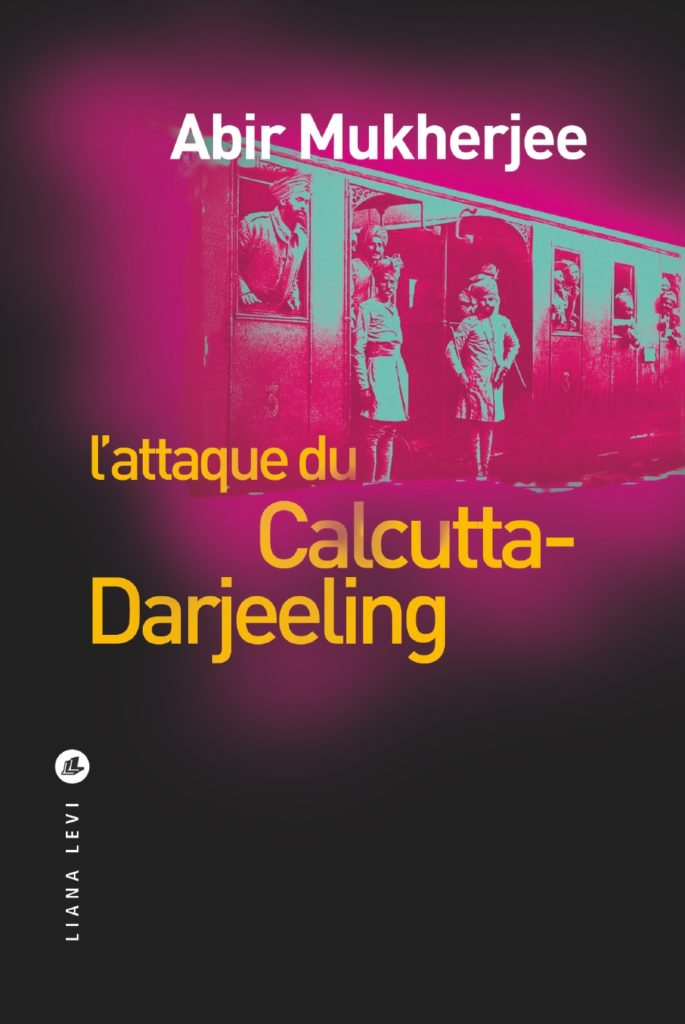Étiquettes
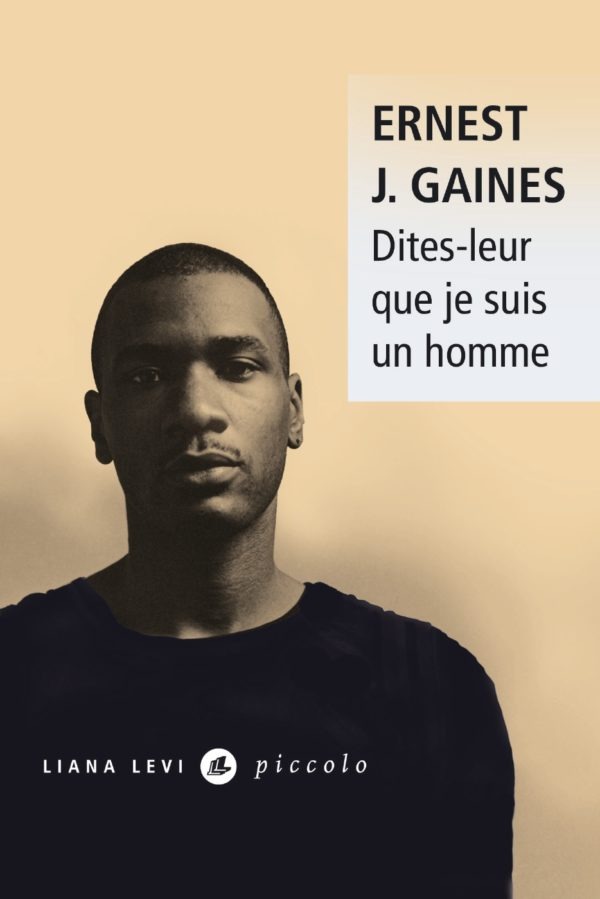
Quatrième de couverture :
Dans la Louisiane des années quarante, Jefferson, un jeune Noir, démuni et illettré, est accusé à tort d’avoir assassiné un Blanc. Au cours de son procès, il est bafoué et traité comme un animal par l’avocat commis d’office. Incapable de se défendre, il est condamné à mort. Commence alors un combat pour que Jefferson retrouve, aux yeux de tous mais surtout de lui-même, sa dignité humaine. Un combat ené par la marraine du condamné qui supplie l’instituteur Grant Wiggins de prendre en charge l’éducation de Jefferson. Un face à face entre deux hommes que tout oppose commence alors…
Jefferson, un jeune Noir illettré, s’est trouvé en mauvaise compagnie, au mauvais endroit et au mauvais moment. C’est sa seule « faute » mais elle lui vaudra d’être accusé de meurtre, jugé de façon expéditive et condamné à la chaise électrique. Lors du procès, l’avocat commis d’office parle de lui comme d’un sous-homme, pas éduqué, dont le niveau est celui d’un porc et sa ligne de défense, c’est : « on ne met pas un porc sur la chaise électrique ». Les mots, d’une violence extrême, retentissent dans toute la plantation où travaillait Jefferson. Ils semblent confirmer que, quels que soient leurs efforts, les jeunes Noirs sont condamnés à finir mal, soit de la faute des Blancs, soit de leur propre violence. Si le pasteur espère sauver l’âme du jeune homme avant son exécution, c’est à l’instituteur Grant Wiggins que Miss Emma, la marraine de Jefferson, demande de l’accompagner jusqu’à la mort et de lui rendre sa dignité d’homme. Grant est éduqué, mais il se sent lui-même en porte-à-faux : il ne rêve que de partir, comme ses parents l’ont fait, le confiant à une de ses tantes, mais il est retenu par la femme dont il est amoureux, en instance de divorce et institutrice comme lui. L’amertume et le désespoir le guettent lui aussi. Aussi cette mission qu’il accepte à contrecoeur et qui semble d’abord vouée à l’échec – Jefferson s’étant enfermé dans le mutisme quand il ne se comporte pas exprès comme un cochon affamé – va lui offrir de réfléchir et d’agir comme jamais auparavant.
Dites-leur que je suis un homme est un roman qui se lit facilement mais qui nous présente une réalité tragique et poignante. La confrontation entre Grant et Jefferson – accompagnée des vexations habituelles des autorités blanches – va paradoxalement conduire l’un et l’autre vers une forme de grandeur, de liberté inouïes. Nous sommes dans les années 40 en Louisiane et le chemin que parcourent les deux hommes annonce les grands combats pour les droits civiques des années 50 et 60. Il n’est pas question de soulèvement organisé mais d’affirmer sans violence le droit au respect, l’égalité des chances pour des gens que tout sépare encore. Au point que cette humanité touche un des adjoints au shérif du lieu.
Né en 1933, Ernest J. Gaines a lui-même été ramasseur de pommes de terre dès l’âge de neuf ans. Il a quitté la Louisiane à l’âge de quinze ans et a fait des études littéraires. Il s’est mis à écrire des romans pour montrer la condition des Noirs dont on ne parlait alors pas en littérature. Il la raconte avec une simplicité et une absence de pathos d’autant plus percutantes. De cet auteur, j’ai déjà lu Par la petite porte et j’attendais de lire un roman plus long pour mieux l’apprécier. C’est chose faite avec Dites-leur que je suis un homme, un roman remuant mais nécessaire.
« Ça a continué encore une demi-heure. Le docteur Joseph [l’inspecteur scolaire ] appelait un enfant qui avait l’air à moitié idiot, puis il appelait un autre qui lui donnait l’impression d’être tout à fait le contraire. Aux classes supérieures, les cours moyen et de fin d’études, il posait des questions de grammaire, de calcul et de géographie. Et après avoir regardé les mains, il se mit à inspecter les dents. « Ouvre grand », « dis aaah », et il obligeait les pauvres petits à écarter les lèvres autant qu’ils le pouvaient pendant qu’il examinait l’intérieur de leur bouche. A l’université j’avais lui que les maîtres faisaient la même chose quand il achetaient de nouveaux esclaves, et que les éleveurs en faisaient autant en achetant des chevaux et du bétail. Au moins le docteur Joseph avait-il atteint le stade où il laissait les enfants ouvrir la bouche eux-mêmes, au lieu d’utiliser un instrument métallique grossier. J’appréciais son humanité. » (p. 68-69)
« J’ai souvent songé à partir, comme le professeur Antoine me l’avait conseillé. Ma mère et mon père m’écrivaient aussi que si je n’étais pas heureux en Louisiane, je devrais venir en Californie. Après être allé les voir l’été qui avait suivi ma première année d’université, j’étais revenu, ce qui avait fait plaisir à ma tante. Mais j’avais tourné en rond depuis, incapable d’accepter ce qui avait été ma vie, incapable de la quitter. » (p. 122)
« Tu sais ce que c’est qu’un mythe, Jefferson ? lui ai-je demandé. Un mythe est un vieux mensonge auquel les gens croient. Les Blancs se croient meilleurs que tous les autres sur la terre ; et ça, c’est un mythe. » (p. 226)
Ernest J. GAINES, Dites-leur que je suis un homme, traduit de l’américain par Michelle Herpe-Voslinsky, Liana Levi piccolo, 2019
Une nouvelle participation au Mois de l’Histoire afro-américaine chez Enna
Petit Bac 2022 – Verbe 2
Liana Levi piccolo fête ses vingt ans