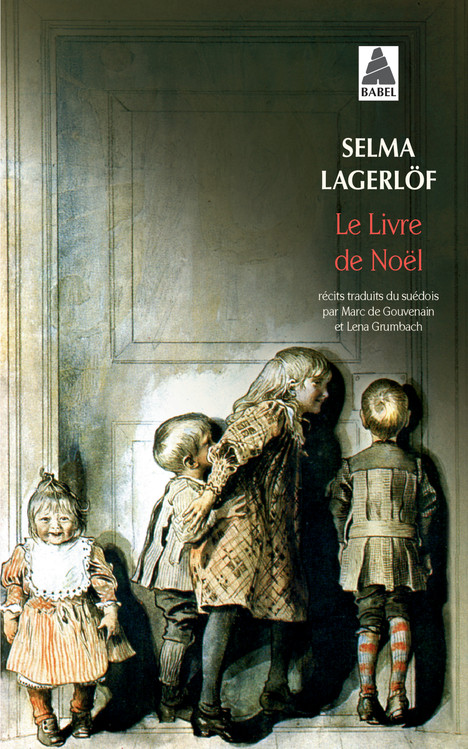Quatrième de couverture :
Il est le frère de “l’Arabe” tué par un certain Meursault dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XXe siècle. Soixante-dix ans après les faits, Haroun, qui depuis l’enfance a vécu dans l’ombre et le souvenir de l’absent, ne se résigne pas à laisser celui-ci dans l’anonymat : il redonne un nom et une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage trop ensoleillée.
Haroun est un vieil homme tourmenté par la frustration. Soir après soir, dans un bar d’Oran, il rumine sa solitude, sa colère contre les hommes qui ont tant besoin d’un dieu, son désarroi face à un pays qui l’a déçu. Étranger parmi les siens, il voudrait mourir enfin…
Hommage en forme de contrepoint rendu à L’Étranger d’Albert Camus, Meursault, contre-enquête joue vertigineusement des doubles et des faux-semblants pour évoquer la question de l’identité. En appliquant cette réflexion à l’Algérie contemporaine, Kamel Daoud, connu pour ses articles polémiques, choisit cette fois la littérature pour traduire la complexité des héritages qui conditionnent le présent.
Ce livre est dans ma PAL depuis sept ans et je dois avouer qu’il me faisait un peu peur. Peut-être est-ce pour cela, pour le sortir de la PAL, que j’ai proposé une semaine Francophonie à Marilyne, tout en sachant qu’elle avait beaucoup aimé ce roman et que j’aborderais le clavier les doigts tremblants pour en parler. Et en effet, j’ai un peu traîné sur ma lecture alors que j’étais saisie par la force du texte et j’ai les doigts tremblants à l’instant où j’écris ce billet.
J’ai lu et relu L’étranger d’Albert Camus, j’adore ce roman et je trouve l’idée de Kamel Daoud à la fois bluffante et vertigineuse : imaginer d’écrire l’histoire du point de vue de « l’Arabe » tué par Meursault, ou plutôt de son frère Haroun, qui a dû porter sa vie durant l’histoire de ce frère assassiné sur une plage d’Alger, que Camus ne cite que comme « l’Arabe », en lui niant ? lui refusant ? une identité qu’Haroun va s’évertuer à lui reconstituer.
Haroun va raconter cette histoire dans un bar rempli de fantômes, où il assume son athéisme face à un personnage sans doute en train d’écrire une thèse. Comme Meursault, Moussa (et Haroun) ont une mère, Haroun a lui aussi été amoureux d’une femme nommée Meriem (l’équivalent en arabe de la Marie de Meursault), il porte lui aussi un crime sur la conscience, qu’il a commis sous l’influence de la lune tandis que Meursault était écrasé de la chaleur du soleil. Ce savant jeu de doubles m’a éblouie : puissance de la littérature qui fait d’une fiction une réalité qui devient elle-même fiction, mise en abyme construite en spirale, se nourrissant du récit pour avancer et aller jusqu’aux limites de l’absurde.
Mais ce premier roman brillant n’est pas qu’un hommage à Camus. On y sent à vif les blessures de la colonisation et de la décolonisation, on y devine l’évolution de la société algérienne jusqu’à une époque où la religion domine le mode de vie et où les femmes ne sont plus aussi libres que la Meriem d’Haroun. Haroun qui, comme Meursault face au prêtre dans sa prison, – autre jeu de doubles – est confronté, à la fin du récit, à l’iman de son quartier oranais.
Enfin, pour tenter de rendre justice à ce texte magnifique, j’ai particulièrement apprécié le style de Kamel Daoud. Je me suis souvent lu des passages à haute voix : le texte m’y appelait, par le choix du narrateur de s’adresser à un « tu » imaginaire, par le genre du plaidoyer et par le choix par Haroun du français comme langue pour comprendre l’histoire de ce frère disparu.
La première page : « Aujourd’hui, M’ma est encore vivante.
Elle ne dit plus rien, mais elle pourrait raconter bien des choses. Contrairement à moi, qui, à force de ressasser cette histoire, ne s’en souviens presque plus.
Je veux dire que c’est une histoire qui remonte à plus d’un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais n’évoquent qu’un seul mort – sans honte vois-tu, alors qu’il y en avait deux, de morts. Oui, deux. La raison de cette omission? Le premier savait raconter, au point qu’il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu’il reçoive une balle et retourne à la poussière, un anonyme qui n’a même pas eu le temps d’avoir un prénom.
Je te le dis d’emblée : le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n’en reste rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera.«
« J’ai tué et, depuis, la vie n’est plus sacrée à mes yeux. Dès lors, le corps de chaque femme que j’ai rencontrée perdait très vite sa sensualité, sa possibilité de m’offrir l’illusion de l’absolu. A chaque élan du désir, je savais que le vivant ne reposait sur rien de dur. Je pouvais le supprimer avec une telle facilité que je ne pouvais l’adorer – ç’aurait été me leurrer. J’avais refroidi tous les corps de l’humanité en en tuant un seul. D’ailleurs, mon cher ami, le seul verset du Coran qui résonne en moi est bien celui-ci : « Si vous tuez une seule âme, c’est comme si vous aviez tué l’humanité entière. »
« J’ai toujours eu cette impression quand j’écoute le Coran . J’ai le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un livre, mais d’une dispute entre un ciel et une créature. La religion pour moi est un transport collectif que je ne prends pas. J’aime aller vers ce Dieu à pied s’il le faut, mais pas en voyage organisé. »
Kamel DAOUD, Meursault, contre-enquête, Actes Sud, 2014
Le très beau billet de Marilyne sur ce roman qui a obtenu le prix des Cinq continents de la Francophonie en 2014
Ainsi s’achève ma semaine Francophonie avec Marilyne qui vous propose de découvrir le roman Em de Kim Thuy. Merci de m’avoir accompagnée durant ce voyage immobile en littérature francophone !