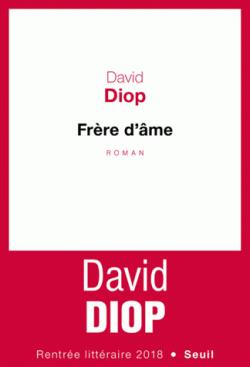Étiquettes
1915, Gallimard jeunesse, Lucy Lost, Lusitania, Michael Morpurgo, Première guerre mondiale

Quatrième de couverture :
Mai 1915. Sur une île déserte de l’archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif. Elle ne parvient à prononcer qu’un seul mot: Lucy. D’où vient-elle? Est-elle une sirène, ou plutôt, comme le laisse entendre la rumeur, une espionne au service des Allemands?
De l’autre côté de l’Atlantique, le Lusitania, l’un des plus rapides et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère, s’apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre…
Nous sommes en 1915, dans les îles Scilly, connues pour leur tradition d’accueil et de secours. Depuis longtemps, les marins-pêcheurs de cette pognée d’îles semées au Sud des Cornouailles portent assistance aux navires qui s’échouent sur ses rochers, au large de ses côtes, et ce quelle que soit l’origine des naufragés. C’est exactement ce que font Jim, Mary et Alfie, le jour où ils trouvent sur l’île de St-Helen’s une petite fille de onze, douze ans exténuée, déshydratée, qui ne livre qu’un mot à ses sauveteurs, « Lucy », et serre contre elle un ours en peluche et une couverture brodée du prénom Wilhelm. Celle que tout le monde va appeler Lucy Lost serait-elle d’origine allemande ? Avec l’aide du docteur Crow, la famille Wheatcroft va tout faire pour soigner Lucy, lui donner confiance, tenter de percer avec elle le secret de ses origines, de lui faire surmonter son état de choc.
Parallèlement à cette histoire, à New York, nous suivons les préparatifs de Merry pour traverser l’Atlantique avec sa mère, afin de rejoindre son père blessé dans les tranchées et au repos dans un hôpital anglais. Le lecteur devine rapidement que Merry et Lucy ne font qu’une mais il lui faudra patienter et traverser bien des épreuves avec Lucy/Merry et son ami Alfie pour comprendre ce qui est arrivé à la petite fille.
On retrouve ici tout ce qui fait le beauté et la force des romans de Michael Morpurgo : une histoire (bien menée) dans la grande Histoire (comme dans Cheval de guerre et Loin de la ville en flammes), du courage, de l’amitié, un lien privilégié entre un cheval et une enfant, des valeurs fortes que les Wheatcroft garderont envers et contre tout. Oui, c’est une belle histoire touchante, bien documentée et très musicale, ce qui ne gâte rien !
« Nous venons tous de quelque part. Moi, d’une certaine façon, je ne viens de nulle part. Laissez-moi m’expliquer. Ma grand-mère a simplement surgi de la mer, il y a longtemps, comme une sirène, sauf qu’elle a deux jambes et pas de queue de poisson. Elle devait avoir une douzaine d’années a l’époque , mais personne n’en était sur, car aucun signe n’indiquait qui elle était, ni l’endroit d’où elle venait. Elle était à moitié morte de faim, égarée par la fièvre, et ne pouvait prononcer qu’un seul mot : « Lucy ».
Voici donc son histoire, telle que je l’ai entendu raconter plus tard par ceux qui l’ont le mieux connue, par mon grand-père, par d’autres amis et relations et, surtout, par elle-même. Au cours des années, j’ai essayé de rassembler toutes les pièces du puzzle et des les mettre en ordre, en ne me servant que des témoignages de ceux qui avaient tout vu de leurs propres yeux, de ceux qui étaient là. » (Première page, p. 9)
Michael MORPURGO, Le mystère de Lucy Lost, traduit de l’anglais par Diane Ménard, Gallimard Jeunesse, 2015
C’est en lisant le billet d’Enna que j’ai eu envie de sortir ce roman pour la journée Jeunesse du Mois anglais.