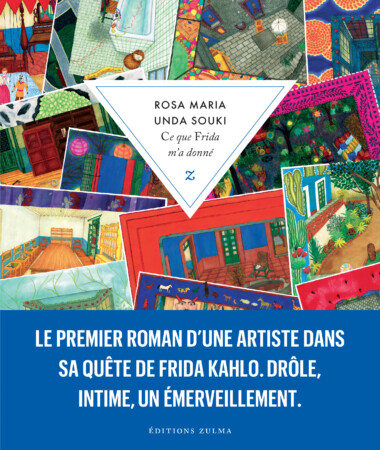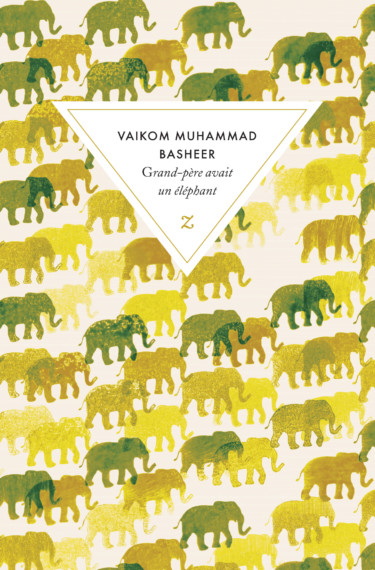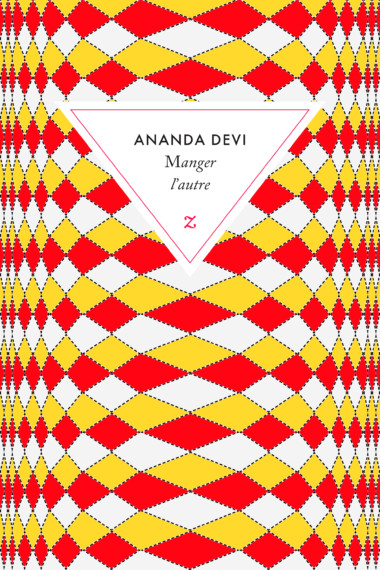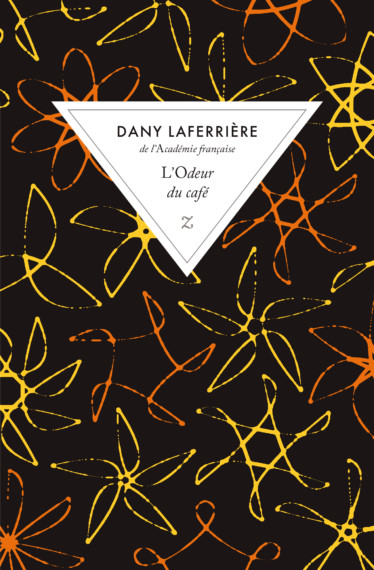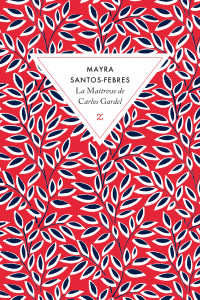Étiquettes

Quatrième de couverture :
Première rédactrice en chef noire d’un célèbre magazine musical, Sunny S. Shelton tient un scoop : Opal & Nev, le duo mythique, se reforme pour un ultime revival, des décennies après leur dernier concert fracassant, à l’été 1970.
Comment Neville Charles et Opal Jewel, si radicalement différents, ont-ils pu bouleverser la scène rock, et comment tout a basculé ce soir-là ? Producteurs, stylistes, musiciens, tous ceux qui les ont côtoyés racontent qui ils étaient – et qui ils sont devenus : lui, songwriter britannique en quête de gloire, et elle, icône afro-punk avant l’heure, rebelle et survoltée…
Voilà un premier roman rock and roll ! Dès le début, on sait que Sunny Shelton mène une enquête sur le retour sur scène d’Opal & Nev parce qu’elle a un lien personnel fort avec ce duo : elle est la fille de Jimmy Curtis, le batteur du duo, avec qui Opal a eu une liaison avant la mort brutale de Jimmy, battu à mort lors d’un showcase de leur maison de disques. De ce concert, il reste une image : Opal grimpée sur le dos de Nev, tous deux fuyant la scène du showcase. Une image omniprésente dans ce roman musical, une image polysémique qui va peu à peu révéler les secrets de cette terrible soirée.
Pour raconter cette histoire, cette relation passionnante et passionnée entre une bête de scène et un caméléon de la scène (selon les mots de l’autrice, rencontrée chez Au Temps Lire le 9 février dernier), Dawnie Walton a fait le choix de l’écriture chorale dans un récit cadre, celui de la démarche de Sunny. Chaque personnage apporte son point de vue sur la rencontre entre Opal et Nev dans les années 60, la difficulté de leur faire connaître le succès, jusqu’à ce showcase organisé par leur label, qui tourne à la catastrophe, et jusqu’à leur retour sur scène, des dizaines d’années après. C’est quand Sunny percera vraiment à jour les secrets d’Opal et la fera tomber du piédestal sur lequel elle l’avait placée qu’elle se mettra elle-même en danger par rapport à sa situation professionnelle gagnée de haute lutte.
Cette histoire se déroule sur fond de racisme : Opal est noire américaine, Nev est blanc d’origine anglaise, le racisme exacerbé dans les sixties ne semble pas avoir beaucoup évolué quand le duo fait son retour. Faut-il préciser que Sunny est elle-même noire et qu’on traque la moindre bourde dans son poste de rédacteur en chef d’une célèbre revue musicale. Dawnie Walton écrivait ce roman pendant la campagne électorale de 2020, l’écriture était une thérapie contre Donald Trump ; elle veut d’ailleurs montrer à travers ce livre que l’Amérique peut aller de l’avant et non régresser dans ses pires cauchemars.
Ce premier roman est vif, énergisant, ses thèmes sont parfois graves mais les pointes d’humour allègent le tout, on y appréciera une galerie de personnages hauts en couleurs (sans mauvais jeu de mots), la plongée dans l’univers du rock, le retour dans les années 60 et j’en passe. Let’s rock !
« Les jeunes fans qui venaient à nos concerts new-yorkais étaient différents de ceux qu’on rencontrait à peu près partout ailleurs. C’est parce que quand on passe du temps à New-York, si on y a grandi ou qu’on a eu la chance de se tirer là-bas, on est branché en permanence sur toutes ces énergies de dingue autours de soi. En sachant qu’un jour, on pourra lâcher la main de sa mère ou les voies haineuses qui nous entourent – enfin, tout ce qui nous empêcher d’avancer – et se glisser sans à-coups dans un autre monde quand il sera temps de devenir la personne qu’on se révèle être. Et s’il s’avère qu’on a au moins la moitié d’un cerveau, un bon œil ou une bonne oreille, un minimum de talent pour malaxer ensemble ces éléments ? Alors là, il y a moyen de devenir le roi en son domaine, tu vois ce que je veux dire ?
Mais dans certains endroits où nous avons joué pendant cette tournée, il y avait des gens qui n’avaient, je crois, jamais eu leur chance, jamais eu conscience de leurs possibilités. Qui voyaient la vie les pousser dans une direction, sans permettre le moindre détour. Tous les gamins qui n’étaient pas blancs, bien évidemment, mais aussi ceux qui étaient gros, gay, qui avaient la fibre artistique, les gamins « personne me comprend », les gamins avec des handicaps physiques ou des défauts d’élocution, des problèmes de peau, des problèmes émotionnels, qui souffraient de mauvais traitements, et ainsi de suite. Des gens plus âgés aussi – tu aurais été surprise en voyant tous ceux qui s’identifiaient à nous. Qui voyaient notre cirque de marginaux débarquer en ville et se disaient qu’eux aussi, ils pouvaient nous rejoindre et être des stars, le temps d’une soirée ou deux. Et pour ces fans-là, en tant qu’Opal & Nev, nous étions davantage que les simples rock stars qu’ils aimaient. Pour eux, nous étions la liberté. » (p. 357-358)
Dawnie WALTON, Le Dernier Revival d’Opal & Nev, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg, Zulma, 2023
En février, c’est le African American History Month chez Enna.